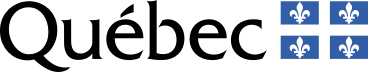L’anthropologue Daniel Ruiz-Serna a documenté les violences écologiques et spirituelles dont ont été victimes des communautés indigènes dans la foulée des conflits armés en Colombie.
Les nombreux dommages collatéraux de la guerre sont souvent invisibles. Parlez-en aux autochtones et Afro-Colombiens du département du Chocó, dans le nord-ouest de la Colombie. Depuis des décennies, ces peuples indigènes vivent sous les feux croisés de groupes armés et de trafiquants de drogue et d’armes. La signature d’un accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie en 2016 n’a rien changé à la situation, déplore Amnistie internationale. Les habitants de cette région sont encore confrontés à des épisodes de violence, qui entraînent «des séquelles qui vont au-delà de l’humain», soutient l’anthropologue Daniel Ruiz-Serna.
Dans sa thèse de doctorat réalisée à l’Université McGill, le chercheur fait état d’une série de blessures que les conflits ont infligée aux territoires traditionnels de ces communautés amazoniennes de même qu’aux myriades d’âmes qui les peuplent. «L’environnement fait partie intégrante de leur identité. Les conséquences des conflits armés sur les animaux, les plantes et les cours d’eau se répercutent directement sur leurs pratiques culturelles», explique celui qui, à l’automne 2019, a reçu le prix de l’Association des doyens des études supérieures au Québec (ADESAQ) en sciences sociales et humaines, parrainé par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture.
Originaire de Colombie, Daniel Ruiz-Serna a travaillé pendant quatre ans pour une organisation non gouvernementale défendant les droits de la personne dans la région du Chocó. Après un séjour à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, il immigre au Québec en 2009 pour y entamer son doctorat, mais aussi pour y rejoindre sa femme et sa famille, qui ont quitté précipitamment la Colombie parce que leur vie était menacée. « On peut donc dire que la guerre m’a touché personnellement. Je me définis de fait comme un chercheur engagé vis-à-vis de mon sujet de recherche, voire comme un chercheur militant », souligne-t-il.
Séquelles multiples
L’originalité des travaux de Daniel Ruiz-Serna tient aux nombreux exemples qu’il répertorie de séquelles occasionnées par la guerre chez ceux qui en ont été des victimes collatérales. Dans sa thèse, il est parfois question de l’intangible, comme des locaux qui rapportent avoir aperçu les esprits errants de personnes qui ont péri brutalement et dont les funérailles n’ont pas été célébrées de manière appropriée. D’autres fois, la spiritualité et le chaos semé dans la nature ne font qu’un.
Daniel Ruiz-Serna évoque entre autres le Río Atrato, une importante voie navigable de la région dont les rives ont été désertées par les habitants à cause du conflit armé. Ceux-ci avaient l’habitude d’en retirer des branches et des résidus végétaux pour faciliter la navigation. Avec l’exode, cette pratique a cessé, ce qui a modifié l’écosystème du cours d’eau et compliqué la circulation fluviale. Mais pour les riverains, cela représentait surtout un dérèglement de la nature. Leur relation avec cette dernière s’en est trouvée chamboulée. « On constate que les hostilités ont des répercussions concrètes sur leur quotidien. Avant de partir à la chasse, ces populations doivent par exemple négocier avec des esprits », raconte le chercheur de 42 ans. Une tâche qu’elles perçoivent comme difficile, voire impossible dans les circonstances.
Le cas d’un jaguar tueur d’humains, responsable de la mort de cinq paysans du Chocó, a tout particulièrement marqué le chercheur. Dans la foulée des conflits, la bête s’est mise à attaquer sans qu’on puisse expliquer pourquoi − en temps normal, l’animal s’en prend plutôt à de petites proies, comme des cervidés ou des serpents. En creusant un peu l’histoire, Daniel Ruiz-Serna a appris que le félin avait été domestiqué par un puissant seigneur de guerre. « Il lui servait de mascotte et avait été entraîné à être violent avec les êtres humains, dont il se nourrissait. À l’arrêt officiel des hostilités, il a tout simplement été relâché dans la nature, où ses attaques ont bouleversé la vie spirituelle collective », indique-t-il.
Au fil de ses recherches sur le terrain, Daniel Ruiz-Serna a acquis une compréhension nouvelle de la violence des conflits armés et de ses séquelles. Cela l’a amené à réviser son point de vue sur des concepts comme la violation des droits de la personne et la réparation des dommages causés par la guerre, puis à s’interroger sur la manière dont la justice colombienne devrait en tenir compte pour favoriser la guérison des victimes. « Quels types de justice et de réconciliation sont envisageables quand la violence armée conduit à une expérience partagée par de multiples humains et non-humains ? » s’interroge-t-il dans sa thèse.
Eduardo Kohn, professeur d’anthropologie à l’Université McGill, a supervisé les travaux de doctorat de Daniel Ruiz-Serna. L’auteur du livre Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de l’humain, qui s’appuie sur plusieurs années de recherche ethnographique auprès des Runa, un peuple d’Amazonie équatorienne, n’est pas surpris outre mesure par la résonance des travaux de son ancien étudiant, qu’il qualifie d’ailleurs d’unique. « Daniel établit des liens entre guerre civile, environnement et humains, frayant ainsi la voie à des concepts tels que la violence écologique et la violence spirituelle. En ce sens, il contribue à ouvrir un nouveau champ d’études en anthropologie, en rupture avec les approches plus classiques », analyse-t-il.

Les questions de Rémi Quirion scientifique en chef du Québec
R.Q. : Considérant votre engagement personnel, quels garde-fous mettez-vous en place pour conserver toute la rigueur et la distance scientifiques nécessaires ?
D.R-S. : L’ethnographie demande, par définition, une immersion dans la réalité des sujets qui nous interpellent. Il s’agit même d’apprendre à vivre une autre vie, de nous laisser habiter par d’autres façons de faire. Alors l’objectivité, conçue comme une connaissance acquise à travers un regard détaché de la réalité, n’y a pas sa place. Par contre, la rigueur ethnographique requiert de consulter une diversité de voix, même celles qui nous rendent mal à l’aise. Elle exige de mettre en contraste les avis de nos interlocuteurs, de poser plusieurs fois les mêmes questions à différentes personnes dans différents contextes et, surtout, de ne jamais tenir pour acquises nos propres interprétations. La rigueur ethnographique nous oblige à faire justice à la polyphonie des voix et des identités rencontrées sur le terrain.
R.Q. : Vos travaux pourraient-ils résonner également chez les peuples autochtones du Canada ? Pourrait-on établir des liens avec leurs expériences et les pistes de justice et de réconciliation ?
D.R.S. : Absolument. Au Canada et en Colombie, tout comme dans d’autres régions du Sud, les peuples autochtones entretiennent des rapports profondément significatifs avec leurs territoires, qui sont beaucoup plus qu’un assortiment de ressources naturelles. Être une personne dans ces territoires signifie toujours d’y vivre en compagnie d’autres entités non humaines et d’êtres qui sont souvent décrits comme des forces spirituelles. J’ai appris que la justice n’est pas seulement une question de respect des droits de la personne : il s’agit surtout de guérir les rapports que ces peuples entretiennent avec leurs territoires, par exemple en leur laissant prendre soin de la diversité des êtres, visibles et invisibles, qui font partie de leur société. Ayant exploré comment cette diversité de vies humaines et non humaines a souffert des conséquences de la guerre dans le cas colombien, je considère que cette même diversité doit devenir l’objet de justice dans d’autres contextes qui, comme celui du Canada, ont favorisé la pauvreté et l’inégalité des peuples autochtones.
R.Q. : Qu’est-ce que le prix de l’ADESAQ représente pour vous ?
D.R.S. : Ce prix est l’aboutissement de plusieurs années de travail, ainsi que de mon parcours de nouvel arrivant entamé il y a 10 ans. Il m’aide à prendre conscience qu’il y a d’autres personnes qui partagent les mêmes champs d’intérêt et questionnements. C’est la reconnaissance de mon regard anthropologique, mais aussi le défi de partager ma recherche avec un public que je n’avais pas envisagé auparavant.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.