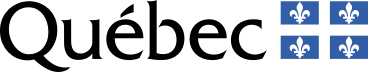Maïka Sondarjee critique sévèrement les relations internationales et le développement. Mais elle passe aussi à l’action pour réduire les inégalités.
À la loterie de la vie, Maïka Sondarjee a pigé le bon numéro. Pourtant, il aurait pu en être autrement pour la professeure adjointe de l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Dès les premières pages de son essai Perdre le Sud : décoloniser la solidarité internationale, paru en août dernier, elle rend hommage à sa grand-mère originaire de Madagascar.
Mariée à 14 ans, celle-ci a travaillé dur pour élever ses 13 enfants, dont plusieurs ont immigré au Canada. «Mon père est arrivé au Québec à 17 ans. Si je compare ma situation avec la sienne, j’ai eu une vie plus facile, n’ayant jamais subi de racisme ou de préjudices raciaux contrairement à lui », raconte-t-elle.
Cette prise de conscience, survenue assez tôt dans son parcours, lui a ouvert les yeux sur les inégalités extrêmes entre habitants du Nord et ceux du Sud. Surtout, elle a pavé la voie à ses recherches qui portent notamment sur les pratiques d’autonomisation des femmes en Inde, le complexe du sauveur blanc en développement international et les politiques étrangères féministes.
« Je ne comprends pas pourquoi notre solidarité devrait s’arrêter à nos semblables, à nos compatriotes. À titre de citoyens du monde, nous sommes tous plus interreliés que jamais ; la pandémie nous l’a d’ailleurs rappelé », affirme la lauréate de la bourse Alice-Wilson de la Société royale du Canada. Cette distinction est attribuée chaque année à trois femmes d’une compétence exceptionnelle qui entreprennent une carrière de professeure ou de chercheuse au postdoctorat.
Dans ses travaux, Maïka Sondarjee déconstruit les relations internationales et le développement, y révélant les liens entre capitalisme, colonialisme, patriarcat et racisme. Dans sa thèse de doctorat, elle expose ainsi les ressorts de ce qu’elle a nommé la «néolibéralisation des pratiques d’inclusion» dans l’élaboration de politiques à la Banque mondiale entre 1980 et 2014. «La Banque mondiale inclut les populations locales dans ses projets afin d’accroître leurs retombées. Malgré sa bonne foi, elle perpétue ainsi un système d’exploitation fondé sur des pratiques technocratiques néolibérales qui sont d’autant plus pernicieuses que les populations du Sud ont en quelque sorte intégré cette manière de faire au fil des années», résume celle qui a obtenu son doctorat en science politique à l’Université de Toronto en 2020.
La jeune chercheuse ne se contente toutefois pas de mettre le doigt sur ce qui cloche dans les rapports Nord-Sud. Elle propose aussi des pistes de solution concrètes qui visent le bien commun et l’émancipation. «On m’a embauchée pour cette raison. Le fait de s’intéresser à des théories féministes des marges, c’est-à-dire non occidentales et non blanches, comme des féminismes indiens, africains, antiracistes, postcoloniaux, autochtones, n’est plus mal vu dans les cercles universitaires », souligne Maïka Sondarjee.
N’empêche, sa position résolument engagée − certains diraient militante − peut parfois écorcher ces mêmes institutions, qu’elle descend en flammes, y compris le monde universitaire. « Faire de la recherche critique ne signifie pas que l’objectivité est absente, nuance celle qui invoque une subjectivité honnête. Quand je parle des mécanismes d’oppression et de déshumanisation, ce n’est pas une invention ; je les observe, les analyse, les décortique. »
Souci de cohérence
C’est d’ailleurs pourquoi la boursière Banting au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) multiplie les engagements extra-universitaires. En 2018, elle a par exemple cofondé Femmes expertes, qui propose un répertoire de plus de 750 intervenantes destiné à valoriser la voix féminine. Une façon de favoriser la parité des genres dans les médias canadiens où, encore de nos jours, plus d’hommes que de femmes sont interviewés.
« Ces derniers répondent souvent plus favorablement à une demande d’entrevue même s’ils ne possèdent pas nécessairement l’expertise pour se prononcer », constate-t-elle. Maïka Sondarjee participe en outre au collectif postcapitaliste La Grande Transition, qui a coordonné l’organisation de deux colloques internationaux majeurs en 2018 et 2019 − celui de 2020 a été annulé en raison de la pandémie.
Depuis l’automne dernier, on peut lire régulièrement les thèses de la chercheuse dans la section Idées du quotidien Le Devoir. Ce désir de tenir le rôle d’« intellectuelle publique » − selon ses propres mots − ne surprend guère Marie-Joëlle Zahar, chercheuse au CÉRIUM et professeure au Département de science politique de l’Université de Montréal. Ensemble, elles ont récemment collaboré à un projet de formation de femmes activistes au Burkina Faso.
« Maïka Sondarjee est passionnée par ses sujets d’étude, en plus d’être une excellente communicatrice, indique-t-elle. Ce genre d’engagement participe d’une logique de cohérence ; elle a un réel souci de traduire ses actions en changements dans la société. »

Les questions de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
RQ : Selon vous, quelle place devrait prendre l’engagement social dans les activités de recherche ?
MS : L’engagement social devrait être au cœur de la recherche, que ce soit par la création d’une recherche transformatrice, la transmission de connaissances en dehors du monde universitaire ou encore la participation des chercheuses et des chercheurs à des initiatives sociales au sein ou à l’extérieur des établissements de recherche. Ce type d’engagement devrait être davantage valorisé par le milieu comme une manière valable de «faire de la recherche».
RQ : Comment vos travaux ou votre engagement pourraient-ils inspirer ceux et celles qui effectuent de la recherche en collaboration avec les Autochtones ?
MS : La recherche avec les Autochtones, comme celle que j’aspire à réaliser avec des personnes en Afrique et en Asie du Sud, doit se dérouler en réelle collaboration, plutôt que dans l’objectif d’extraire des données pour la publication d’articles ou de livres. Pour ce faire, nous devons cesser de dévaloriser certains savoirs et certains imaginaires au profit de concepts scientifiques occidentaux. Quand on travaille avec des communautés marginalisées, la décolonisation de la pensée est un processus continuel et toujours en construction.
RQ : Que pensez-vous des avancées des milieux de la recherche sur les questions d’équité, de diversité et d’inclusion ?
MS : Le combat contre le racisme systémique et le sexisme dans les universités est loin d’être terminé, mais il y a tout de même des évolutions palpables depuis les dernières années en ce qui a trait aux inégalités dans le monde de la recherche. Pour continuer dans cette voie, les chercheurs et les chercheuses doivent prendre conscience de leurs propres biais dans l’embauche, l’enseignement et l’attribution de tâches administratives, ainsi que dans le financement et la réalisation de la recherche.
Cette entrevue est parue dans Québec Science, un magazine scientifique pour le grand public.